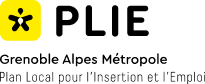Focus Service d’Investigation et d’Action Auprès de la Justice (SIAAJ)
Focus du jour
Le Service d’Investigation et d’Action Auprès de la Justice (SIAAJ) est une association loi 1901 créée en décembre 2015 en Rhône‑Alpes ; elle mène des enquêtes de personnalité et accompagne judiciairement et socialement des personnes placées sous main de justice, dans une démarche de prévention de la récidive et d’individualisation de la réponse pénale. Son modèle se fonde sur une équipe pluridisciplinaire – intervenants socio‑judiciaires, juristes, psychologues – déployant des parcours alliant cadre judiciaire, soutien humain, insertion professionnelle et accès aux droits. Depuis juillet 2024, le SIAAJ a renforcé son offre en recrutant un chargé d’insertion professionnel, chargé de guider les personnes suivies vers l’emploi, la formation et l’autonomie, dans le cadre du PLIE de la Métropole de Grenoble, cofinancé par le FSE."Notre objectif est d’aider ces personnes à se reconstruire sans occulter la gravité des faits. L’idée n’est pas de les excuser, mais de ne pas les réduire à leurs actes. C’est cette approche qui, je crois, permet aussi de prévenir la récidive."
Entretien avec Clémentine Cingolani, chargée d’insertion au sein de l’association SIAAJ
1. Pouvez-vous nous expliquer le rôle de l’association SIAAJ et les spécificités de votre accompagnement ?
L’association SIAAJ est mandatée par le ministère de la Justice pour accompagner des personnes placées sous main de justice, principalement sous contrôle judiciaire ou dans le cadre de sursis avec mise à l’épreuve. Notre mission consiste à soutenir ces publics souvent très éloignés de l’emploi et des structures sociales classiques, en intervenant sur des problématiques variées : insertion professionnelle, respect des obligations judiciaires, accès aux droits, suivi psychologique, etc.
Dans ce contexte, mon rôle en tant que chargée d’insertion est d’aider les personnes à retrouver une forme d’autonomie. Cela passe par des démarches basiques (accès aux soins, reprise de contact avec les institutions, formation, emploi), mais aussi par une adaptation aux contraintes judiciaires (interdictions de territoire, obligations de soins, etc.). Le travail est souvent lent, fragmenté, mais nécessaire pour éviter la récidive.
2. En quoi cet accompagnement diffère-t-il de celui proposé à un public éloigné de l’emploi mais non judiciarisé ?
Le public que nous accompagnons présente souvent de grandes fragilités : difficultés émotionnelles, rupture avec les codes sociaux, expériences carcérales... Cela impose une posture particulière et un accompagnement sur mesure. Travailler l’insertion ici, ce n’est pas seulement parler CV ou entretien : c’est aider quelqu’un à se présenter à un rendez-vous, à gérer ses émotions, à respecter des règles de base, voire à penser à mettre des chaussures. L’insertion ne peut pas être envisagée indépendamment du cadre judiciaire. Nous devons articuler nos actions avec celles des intervenants socio-judiciaires, des psychologues, et d'autres structures, en respectant les obligations fixées par les juges.
3. Quelles sont les coopérations mises en place pour permettre cet accompagnement global ?
La force de notre approche réside dans le travail d’équipe et la pluridisciplinarité. Nous avons des échanges constants entre intervenants socio-judiciaires, psychologues, assistantes sociales, et parfois lors d’entretiens tripartites avec les personnes suivies. Ces moments de croisement sont essentiels : ils évitent les doubles discours, permettent de poser un cadre clair et d’aligner les objectifs. Nous travaillons aussi avec des partenaires extérieurs : chantiers d’insertion, France Travail, maisons de l’emploi... Cela dit, nous avons encore besoin de mieux faire connaître notre mission. La confusion avec les SPIP (services pénitentiaires d’insertion et de probation) est fréquente, alors que notre structure associative a un fonctionnement distinct.
4. Avez-vous un exemple d’accompagnement marquant et que retenez-vous de cette expérience ?
Je pense notamment à un homme que j’ai accompagné dès mes débuts. Après plusieurs années de contrôle judiciaire, il avait trouvé un logement, cessé sa consommation d’alcool, repris un emploi... Mais son procès a abouti à une condamnation, et il a été incarcéré. Ce fut un moment difficile : l’accompagnement avait porté ses fruits, mais le calendrier judiciaire l’a stoppé net. Cela illustre bien la complexité de notre travail : il faut concilier humanité et cadre judiciaire.